Lundi je suis allé au travail. Je fais toujours le même trajet. Je descends notre rue, puis je traverse le pont qui m’amène de mon île sur l’autre île. La cathédrale apparaît brutalement. Elle se dégage peu à peu d’un mur d’immeubles. D’abord apparaît l’abside, puis les tours. Elles s’entassent monstrueusement. Je tourne à droite et continue mon chemin, hâtivement je traverse la colonnade des châtaigniers. Et dans l’ombre des tours, sous le rire moqueur des gargouilles, j’ouvre la porte. Je traverse la cour, j’ouvre une deuxième porte, je monte les escaliers et j’ouvre mon armoire. J’en retire la blouse blanche aux grandes poches et je l’échange contre ma veste. Je suis médecin. C’est ma profession et ma vie. En tout cas sur cette île. Sur l’autre île. Sur mon île je suis serveur dans un petit restaurant. Mais celle-ci, c’est l’autre île.
 Je ne voulais pas faire de mal à ma mère. Elle comprenait bien que j’attendais plus de ma vie que d’être un simple serveur dans un restaurant, c’est pourquoi elle m’a volontiers accordé des études. Mais le restaurant, c’est tout pour elle. Cela a toujours été une entreprise de famille – depuis plusieurs générations déjà. Il y a cinq ans, mon père est mort, son mari adoré. Je n’ai ni sœur, ni frère, c’est pourquoi c’était à moi de le remplacer - ou de briser le coeur de ma mère. Je me suis plié aux circonstances et j’ai cherché un poste de médecin qui était compatible avec ma mère et avec le restaurant. L’autre île se situe à proximité de la nôtre, il n’y a qu’un pont qui les sépare l’une de l’autre. Depuis, je suis médecin sur l’autre île. Depuis j’ai deux métiers et deux vies, bien distribuées sur les deux îles, et unies seulement par le pont entre elles. Parfois, pour parler sincèrement, tout me paraît cassé en deux. Parfois tout me semble brisé en morceaux – et pourtant : heureusement. Heureusement que ma vie est distribuée sur les deux îles. Car je ne pourrais jamais exercer mon travail sur la mienne. Je ne peux le faire que sur l’autre île.
Je ne voulais pas faire de mal à ma mère. Elle comprenait bien que j’attendais plus de ma vie que d’être un simple serveur dans un restaurant, c’est pourquoi elle m’a volontiers accordé des études. Mais le restaurant, c’est tout pour elle. Cela a toujours été une entreprise de famille – depuis plusieurs générations déjà. Il y a cinq ans, mon père est mort, son mari adoré. Je n’ai ni sœur, ni frère, c’est pourquoi c’était à moi de le remplacer - ou de briser le coeur de ma mère. Je me suis plié aux circonstances et j’ai cherché un poste de médecin qui était compatible avec ma mère et avec le restaurant. L’autre île se situe à proximité de la nôtre, il n’y a qu’un pont qui les sépare l’une de l’autre. Depuis, je suis médecin sur l’autre île. Depuis j’ai deux métiers et deux vies, bien distribuées sur les deux îles, et unies seulement par le pont entre elles. Parfois, pour parler sincèrement, tout me paraît cassé en deux. Parfois tout me semble brisé en morceaux – et pourtant : heureusement. Heureusement que ma vie est distribuée sur les deux îles. Car je ne pourrais jamais exercer mon travail sur la mienne. Je ne peux le faire que sur l’autre île. Je salue les secrétaires, ensuite j’entre dans la salle de surveillance, j’observe l’écran et j’attends jusqu’à ce qu’ils arrivent. L’écran montre ce que la caméra enregistre dans le couloir et dans la salle d’attente du rez-de-chaussée. Quand ils arrivent, j’attends encore quelques minutes jusqu’à ce que l’infirmière ait terminé de tout préparer. Puis je descends les escaliers. Ceux qui viennent d’entrer sont un groupe de policiers et un criminel. Je suis médecin de police. C’est-à-dire que je suis un médecin autonome mais je travaille sur demande de la police. Je réponds à ses questions. Le plus souvent je vérifie si l’état de santé des criminels est compatible avec leur placement en garde à vue. A part cela, il n’y a aucun lien entre la police et moi et on peut dire que la police et moi, on vit dans deux mondes rigoureusement séparés.
Je sais de quoi je parle si je dis que c’est une image impressionnante que de voir trois ou quatre, voire cinq policiers dans leur uniforme raide, bleu foncé, mal ajusté, équipés chacun d’un pistolet, d’un bâton et de menottes, quand ils amènent un seul criminel ayant les mains attachées dans le dos. C’est une image rare de surpoids et de déséquilibre. Au départ j’étais très étonné. J’ai passé mon enfance et ma jeunesse sur les deux îles, mais pendant toutes ces années je n’ai jamais vu un criminel par ici, jamais et nulle part. Alors qu’ici, au coeur des lieux de mon enfance, il en arrive plein, jours et nuits. Je me suis demandé au départ par quel chemin ils arrivaient, par quel chemin caché, mais je n’ai pas trouvé la réponse et j’ai abandonné ma recherche.
Je fais des certificats. L’infirmière a préparé le certificat vierge et l’a déposé sur mon bureau. Suit alors le rituel. Je les appelle par leur nom et ils viennent, les policiers et le criminel, je suis posté dans l’encadrement de la porte, ils sont dehors dans le couloir, et l’un des policiers dit:
« Je détache? »
« Mais oui. »
C’est ça, le rituel. Leur question et ma réponse. Car il n’y a pas de question à poser et pas de réponse à donner. On ne peut pas examiner une personne correctement qui a les mains attachées dans le dos et si jamais il y a une raison de ne pas la détacher, c’est l’affaire des policiers de le savoir et pas la mienne, parce qu’on travaille de manière autonome et séparée ici, et je ne sais absolument pas pourquoi et dans quelle mesure les criminels que j’examine sont des criminels. C’est la police qui le sait, pas moi. De plus je pars du principe qu’ils ont vidé les poches des criminels et qu’ils interviendront si jamais cela s’avère nécessaire. Ils sont équipés pour cela finalement.
Je fais des certificats. Le certificat vierge prévoit trois lignes pour les plaintes, cinq lignes pour l’examen, deux cases à cocher - soit « compatible », soit « non compatible ».
Au départ, je demandais aux criminels comment ils allaient. Mais j’ai abandonné cette question parce que ce fait est sans aucun intérêt. Je fais des certificats qui aboutissent soit à la conclusion « compatible » soit à la conclusion « non compatible », c’est tout. Il est sans intérêt de savoir comment ils vont au-delà de ça parce que ça ne change en rien le certificat et de toute façon, je ne les vois plus jamais après les cinq minutes que cela me prend pour l’établir. Les choses sont séparées ici. La médecine et la justice sont séparées et les policiers et les criminels le sont également, même si cela n’a pas l’air d’être le cas à première vue. En quoi ça me concerne que je me trouve devant toute une histoire, devant toute une vie? Je suis là pour établir des certificats. Certes, on pourrait objecter que les certificats sont inadaptés. Mais ils sont comme ils sont. Ce n’est pas moi qui les ai faits.
Je commence par les plaintes. Je note: avoir peur, avoir mal, être enfermé, ne pas pouvoir dormir, être paniqué, être dans une cage, avoir chaud et froid, être en manque, avoir des brûlures à l’estomac, ne pas pouvoir respirer etc. Puis j’examine. Je prends la tension, j’ausculte le coeur, ça fait toctoctoc, j’ausculte les poumons, ça fait chhrchhrh, j’appuie sur le ventre, j’éclaire les pupilles, elles se contractent. Je note ça sur les cinq lignes. Puis je coche en règle générale la case qui dit « compatible » et j’efface l’autre.
Au début j’étais tenté de noter les traces rouges sur les poignets aussi, parce que de mon point de vue, il n’y a pas lieu de serrer les menottes de telle sorte qu’elles laissent des traces douloureuses sur les poignets. Car les menottes légèrement serrées ne peuvent pas s’échapper non plus du fait que le diamètre de la main est plus grand que celui du poignet. Il s’agit là du même principe que pour les bagues qui ne tombent pas des doigts et qui ne laissent pas de marques rouges non plus. Mais ça aussi, ça ne m’étonne plus. Je ne connais plus la tentation de noter les traces rouges sur les poignets, car je les ai vues trop souvent et j’en ai finalement pris l’habitude. De plus je me dis que ça ne me regarde pas et que les policiers ont, comme moi, appris leur métier et qu’ils doivent par conséquent savoir comment mettre correctement les menottes.
Enfin j’établis une ordonnance pour les criminels en fonction des plaintes et de l’examen. Je prescris presque exclusivement des médicaments contre la douleur, contre la peur, contre les brûlures à l’estomac, contre la dyspnée, contre l’insomnie, contre le manque en héroïne et contre les attaques de panique. Tout se passe très vite. Sauf si je prescris la Méthadone. Alors, ça dure. Car il n’y a pas de réserve en Méthadone dans le service médico-judiciaire et la réglementation de délivrance est très stricte. Selon le règlement en vigueur, la Méthadone doit être récupérée dans le département de sécurité de la pharmacie sur présentation d’une ordonnance spéciale, numérotée, rouge foncé et il doit par la suite être administré aux toxicomanes en ma présence. Ainsi il arrive de temps à autre qu’au moment où la Méthadone est enfin amenée, les criminels ont de nouveau les mains attachées dans le dos. Dans ces cas-là, j’ouvre le flacon moi-même et je verse moi-même son contenu dans leur bouche. Au départ ça me faisait penser à une sorte d’exécution, mais j’ai pris l’habitude et je trouve ça moins grave maintenant.
D’ailleurs, la prise de la Méthadone prend dans tous les cas un certain temps. Il est frappant d’observer comment les criminels font remplir le flacon vide une deuxième fois avec de l’eau, pour être sûrs d’avoir avalé tout le contenu. Car pour un toxicomane, c’est ça le plus important dans la vie: avoir la dose entière. Toute autre chose s’efface devant ce désir. Je connais trois médicaments pour lesquels je sais que les malades sont prêts à se mettre à genoux devant un médecin afin de les obtenir: La Morphine contre la douleur, le Valium contre la peur et la Méthadone contre la terreur du manque d’héroïne. Ces trois médicaments sont parfois la seule condition pour pouvoir continuer à exister. Au départ, quantité de choses que j’observais ici me donnaient la nausée mais j’ai fini par m’y habituer, et puis finalement il y a les victimes aussi.
Les victimes prononcent presque toutes la même plainte. Et dans la plupart des cas, elles ne mentent pas. Elles reçoivent des coups de poing dans la figure jusqu’à ce qu’elles tombent et une fois tombées à terre, les coups de poing sont remplacés par des coups de pied. Les agresseurs choisissent le système le plus efficace et qui demande le moindre effort. Les victimes arrivent effondrées en larmes chez moi, elles tremblent et pleurent, elles sont consternées et répètent à plusieurs reprises, apparemment parce qu’elles n’arrivent pas à intégrer ce fait, que personne ne les a aidées bien qu’il y ait eu des témoins qui ont tout vu. Elles disent que les témoins ne font que regarder la scène de loin jusqu’à ce que l’agression soit terminée, ensuite ils arrivent pour aider les victimes à se redresser et les accompagnent au bureau de police. Après avoir entendu les plaintes, je compte les hématomes, les fractures, les coupures, j’évalue l’intensité des pleurs et de l’anxiété, je note tout cela dans un dossier et j’établis un certificat.
Ceux qui mentent, ce sont les parents qui me sont amenés par la police avec leurs enfants. Ils affirment que les lésions que présentent les enfants sont dues à des événements accidentels. Mais il est peine perdue de me mentir. Je sais qui ment et qui dit la vérité, même sans avoir examiné l’enfant. Et je ne me trompe pas. Je ne me trompe jamais. Je ne nie pas que mon poste soit modeste mais j’ai appris à l’exercer à la perfection. Car personne ne peut me tromper. Un seul regard dans les yeux des parents suffit pour apprendre s’ils sont honnêtes ou s’ils mentent et je le sais d’autant plus après qu’ils aient prononcé le premier mot. Je connais le regard et le son des mots de ceux qui mentent et de ceux qui disent la vérité. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe jamais. Je suis le maître des traces. Je sais tout.
 Mardi c’était mon anniversaire. C’était le trente-deuxième. J’ai hâtivement traversé comme tous les jours la colonnade des châtaigniers, sous le rire moqueur des gargouilles, je me suis approché de la blouse blanche aux grandes poches. Mais soudain j’ai été pris d’une répulsion. Je me suis arrêté. Et j’ai fait demi-tour. Je me suis dit que j’avais le droit à cela parce que c’était mon anniversaire. Pourtant je n’avais rien à attendre. Mon cadeau, une montre, ma mère me l’avait donné il y a presque une semaine déjà. J’ai poursuivi mon chemin en choisissant des rues opposées à mon trajet habituel, je me suis engagé dans une ruelle qui était bordée d’étroites maisons médiévales. J’étais à l’aise auprès de ces demeures étriquées, serrées les unes contre les autres, parcourues de colombages, avec leurs toits raides et pointus. J’étais toujours très proche de la cathédrale. Je voyais transparaître des fragments de la grande rosace du mur latéral à travers les fines fissures entre les vieilles maisons. Enfin je suis descendu sur les quais du fleuve. Sur l’eau grise flottaient deux cygnes. Ils flottaient l’un à côté de l’autre, sans jamais se quitter. Un vieil homme était accoudé à une balustrade du quai. Il était vêtu d’un imperméable très épais et il avait le regard fixé calmement sur un point lointain dans l’eau. Par des chemins détournés je me suis approché du grand pont en pierre de taille qui me ramène sur mon île. En chemin j’ai de nouveau aperçu la cathédrale. Elle étincelait d’un éclat doré dans la lumière de l’aube. Elle me faisait moins de soucis vue de loin. J’ai posé mon regard sur la partie éloignée des tours, sur les arcs-boutants en forme de lignes brisées semblables à des cristaux – dans la lueur radiante d’un matin d’hiver, dans le calme, dans la froideur, et j’ai poursuivi mon chemin, j’ai quitté de nouveau mon île pour descendre le boulevard principal pendant un temps, jusqu’à ce que j’aperçoive tout au bout d’une rue qui monte, la coupole du dôme, une demi-sphère argentée déployée dans le ciel. J’ai monté la rue. Sur le parvis, il y avait un petit bois de sapins artificiels. Les branches des arbres et le sol étaient blanchis par de la neige artificielle. Au-dessus, s’étendait l’ovale de la bâtisse. Il était d’une simplicité et d’une harmonie qui m’ont profondément rassuré. J’ai poursuivi mon chemin. Je n’ai rien d’autre à faire. J’erre dans la ville d’hiver jusqu’à la tombée de la nuit.
Mardi c’était mon anniversaire. C’était le trente-deuxième. J’ai hâtivement traversé comme tous les jours la colonnade des châtaigniers, sous le rire moqueur des gargouilles, je me suis approché de la blouse blanche aux grandes poches. Mais soudain j’ai été pris d’une répulsion. Je me suis arrêté. Et j’ai fait demi-tour. Je me suis dit que j’avais le droit à cela parce que c’était mon anniversaire. Pourtant je n’avais rien à attendre. Mon cadeau, une montre, ma mère me l’avait donné il y a presque une semaine déjà. J’ai poursuivi mon chemin en choisissant des rues opposées à mon trajet habituel, je me suis engagé dans une ruelle qui était bordée d’étroites maisons médiévales. J’étais à l’aise auprès de ces demeures étriquées, serrées les unes contre les autres, parcourues de colombages, avec leurs toits raides et pointus. J’étais toujours très proche de la cathédrale. Je voyais transparaître des fragments de la grande rosace du mur latéral à travers les fines fissures entre les vieilles maisons. Enfin je suis descendu sur les quais du fleuve. Sur l’eau grise flottaient deux cygnes. Ils flottaient l’un à côté de l’autre, sans jamais se quitter. Un vieil homme était accoudé à une balustrade du quai. Il était vêtu d’un imperméable très épais et il avait le regard fixé calmement sur un point lointain dans l’eau. Par des chemins détournés je me suis approché du grand pont en pierre de taille qui me ramène sur mon île. En chemin j’ai de nouveau aperçu la cathédrale. Elle étincelait d’un éclat doré dans la lumière de l’aube. Elle me faisait moins de soucis vue de loin. J’ai posé mon regard sur la partie éloignée des tours, sur les arcs-boutants en forme de lignes brisées semblables à des cristaux – dans la lueur radiante d’un matin d’hiver, dans le calme, dans la froideur, et j’ai poursuivi mon chemin, j’ai quitté de nouveau mon île pour descendre le boulevard principal pendant un temps, jusqu’à ce que j’aperçoive tout au bout d’une rue qui monte, la coupole du dôme, une demi-sphère argentée déployée dans le ciel. J’ai monté la rue. Sur le parvis, il y avait un petit bois de sapins artificiels. Les branches des arbres et le sol étaient blanchis par de la neige artificielle. Au-dessus, s’étendait l’ovale de la bâtisse. Il était d’une simplicité et d’une harmonie qui m’ont profondément rassuré. J’ai poursuivi mon chemin. Je n’ai rien d’autre à faire. J’erre dans la ville d’hiver jusqu’à la tombée de la nuit. Il y a des criminels qui ne sont ni accompagnés par des policiers ni ligotés dans le dos. Ils se promènent en toute liberté dans le couloir. Au départ cette espèce de criminels m’a particulièrement étonné. Mais ce ne sont pas des criminels. Ce sont des criminels qui font semblant d’en être, mais qui, en réalité, sont de notre côté. « Ce sont des agents déguisés en délinquants pour infiltrer le milieu », m’a-t-on expliqué.
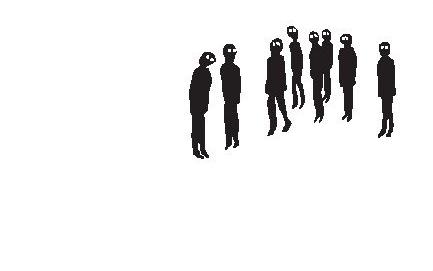 « Vous savez », m’a expliqué l’une des infirmières, « ce sont des gens très raffinés. Ils s’installent par exemple avec toi dans le train et affichent un air de complicité, ils font semblant d’être sur la même longueur d’onde que toi. Ainsi, ils te font parler pour obtenir les informations qui les arrangent... jusqu’à ce que tu aies parlé un peu trop, et ensuite ils sortent les menottes ... et voilà, c’est comme ça que ça se passe ».
« Vous savez », m’a expliqué l’une des infirmières, « ce sont des gens très raffinés. Ils s’installent par exemple avec toi dans le train et affichent un air de complicité, ils font semblant d’être sur la même longueur d’onde que toi. Ainsi, ils te font parler pour obtenir les informations qui les arrangent... jusqu’à ce que tu aies parlé un peu trop, et ensuite ils sortent les menottes ... et voilà, c’est comme ça que ça se passe ». Avec le temps je me suis habitué à tout, mais pas aux agents. Les agents m’ont marqué. Ils ont laissé en moi une sorte de plaie qui n’a plus jamais guérie. Car au moment où j’ai cerné leur manière de fonctionner, leur trahison de routine, quelque chose s’est mis en désordre au plus profond de moi. Depuis ce jour-là, je me retire de plus en plus dans mon for intérieur, semblable à une de ces poupées en bois, qui cachent en elles toujours une autre un peu plus petite, qui se rétrécissent successivement quand on ouvre leurs coquilles. Je ne sais plus avec qui je parle depuis que j’ai percé à jour le fonctionnement des agents – je ne sais plus si j’adresse la parole à celui à qui je pense l’adresser ou à un agent. Car tout le monde peut être un agent. Ils ont annihilé les notions les plus fondamentales de mon raisonnement. Car je ne peux pas les reconnaître. Sauf si je suis suspicieux. Si je me mets à soupçonner le plus possible, alors il me semble que je parviens même à reconnaître les agents et à les distinguer des autres. Mais on ne peut pas soupçonner tout le temps. C’est pourquoi il faut prendre la fuite devant eux en faisant semblant soi-même, en se transformant en fantôme, en se plaçant soi-même à l’intérieur de la poupée. Bien sûr cela n’est pas vraiment possible. On reste qui on est. Mais je croyais que je pouvais devenir l’une de ces poupées intérieures, que je pouvais habiter moi-même en moi-même, en dessous d’une peau mensongère. Ainsi il ne serait resté que deux fantômes – l’agent et moi transformé en une petite poupée dans le ventre de la grande, - qui se parlent, qui se trompent.